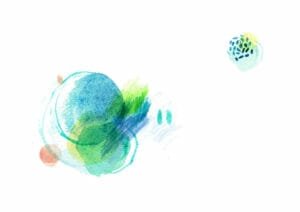La mort est mon métier, le plus beau du monde.
Un texte d’Olivier Bernard, médecin responsable d’une unité de soins palliatifs et formateur au CEFEM
Je suis médecin, responsable d’une unité de soins palliatifs et principalement payé à ne rien faire.
Souvent, on me dit en joignant la pitié à la parole : « ce doit être dur de travailler dans ce domaine ».
Travail ? Je ne produis rien, de matériel. Dur ? Je ne connais rien de plus doux.

Mon « travail » consiste en effet à en faire le moins possible, juste être présent, écouter la personne que je rencontre dans ce cadre propice à la vérité. Au moins j’en fais, au plus je peux me rendre disponible pour entrer en résonnance avec l’autre. Au plus cet autre se sent compris et accueilli. Cette présence inconditionnelle se révèle être un excellent traitement. La personne écoutée internalise l’accueil radical qu’elle perçoit chez l’écoutant.e vis-à-vis de ce qu’elle est et raconte de sa vie.
La maladie devient alors accessoire, elle reprend sa juste place, celle qui vient après ce qui est essentiel. On ne peut plus rien faire contre elle, alors on fait la paix. Et on peut commencer à être, habiter un espace-temps qui se dilate. Tant et si bien que cette maladie devient une petite partie de l’expérience, parmi tant d’autres beaucoup plus importantes.
Et la personne de pouvoir vivre pleinement l’instant, éprouver intimement son expérience.
« Oui mais vous côtoyez la mort » me répond-on.
Je ne pense pas qu’il y ait un service hospitalier qui soit aussi vivant qu’une unité palliative. Voici quelques faits récents, parmi d’autres, qui ont égayé ces dernières semaines.
Il y a d’abord eu le carnaval. En soins palliatifs, on dit « carna-pal ». Une période de réjouissance pendant laquelle on défile ou on défie l’ordre établi. Nous, on avait déjà les masques, on a ajouté les perruques. Ce qui a provoqué des ondes de fous rires chez nos patient.e.s. Se déguiser, retourner ou détourner la blouse blanche et afficher que tout cela n’est pas aussi sérieux qu’il y parait.
S’en suivit quelques jours plus tard un goûter d’anniversaire. Une quinzaine d’invités, et cette fois, bas les masques. Au moins autant de gâteaux, du fait maison, des jus de fruits, des banderoles, des bougies, de belles nappes et des petits cœurs. Avec invitation spontanée aux occupants des autres chambres, au passage. Le salon vibrait encore des rires le lendemain et le frigo débordait des restes du festin.
Hier, un de nos jeunes patients de 89 ans petit-déjeunait sagement. En lui donnant son café au lait, son jus d’orange préféré et quelques tartines beurrées à la confiture, il aperçut une bouteille de vin que sa famille avait apporté la veille à son attention. Le fait est que le soir, avec la fatigue, l’envie de déguster ce bordeaux rouge supérieur, celui dont il raffole, n’y est plus. Mais là à 9h du matin, le peut-il ? Et pourquoi pas ? Le voilà qui rajouta à son menu matinal trois gorgées de ce nectar bues à la paille avant de ré adoucir son palais avec un yaourt à la vanille. Je n’oublierai pas la joie qui pétillait dans son regard.
Ce matin, une de nos patientes a pris un bain. Jusque là, rien d’extravagant me direz-vous. Souvent il s’accompagne de jets d’eau, de massage de la nuque ou des pieds. Et ici, la harpiste-thérapeute a rajouté la note finale. Notre soliste s’est produite juste pour les oreilles de cette patiente, qui a pu se baigner dans le flot des mélodies jouées à sa mesure. Elle n’eut que deux mots en sortant de l’eau : « divin, divin ».
De petits instants magiques, uniques, gravés dans la mémoire de chacun.e. Avec comme ingrédients, la sérendipité, la spontanéité et l’ouverture aux chemins de traverse.